La Catalogne dans le moment populiste
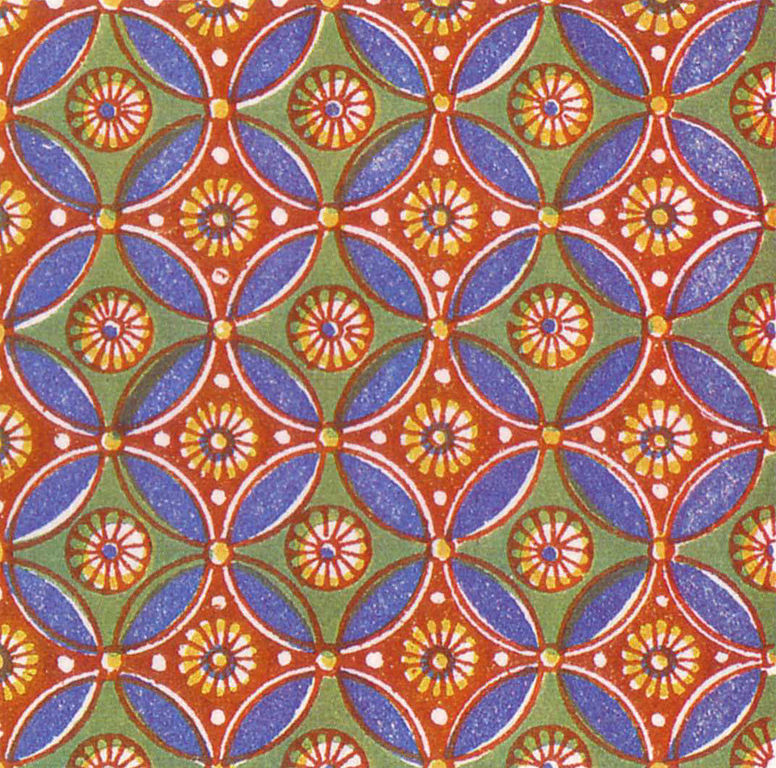
Le 1er octobre 2017, en Catalogne, des masses de gens ont bravé la police afin d’aller voter, et se sont trouvés confrontés à la répression pour avoir participé à un référendum organisé par leur gouvernement, et déclaré inconstitutionnel par l’Etat espagnol. L’image de personnes pacifiques, traînées au sol et battues par la Guardia civil dans le cadre familier d’une école servant de bureau de vote a en effet de quoi choquer. Ce référendum a dès lors pris l’aspect d’un « soulèvement démocratique » au cœur de l’Europe (quoi de plus démocratique qu’un référendum ? et qu’un pays européen ?) plongeant dans l’embarras y compris ceux qui y étaient opposés, de Podemos aux instances de l’Union européenne. On peut facilement condamner des politiciens ou des partis extrémistes, mais l’organisation du référendum est parvenue à donner l’image d’un peuple allant pacifiquement voter, ce qui est au fondement idéologique de l’Etat moderne, et brutalement réprimé par son propre Etat.
Tous les Etats européens se sont constitués, chacun à leur manière, sur la négation ou l’absorption des identités particulières présentes sur « leur » territoire, ce dont il reste évidemment des traces encore aujourd’hui. Mais si la question culturelle joue un rôle en Catalogne, ce n’est que comme cadre d’ensemble à une entité « Catalogne » qui reste avant tout comprise de façon économique. Ce qui est mis en avant dans les revendications, c’est moins la question de l’identité ou celle de la langue (en Catalogne, on soutient sa thèse en catalan) que celle de la fiscalité excessive qui briderait le développement de la région et contraindrait le gouvernement de la Generalitat à appliquer des mesures d’austérité imposées par Madrid. La question catalane pose alors la question des rapports entre l’Etat et le capital. Dans ce conflit, la formulation idéologique des rapports entre l’Etat, le « peuple » et l’économie devient un enjeu spécifique au sein de rapports de classes bien réels.
Après la crise de 2008, l’Etat est apparu comme étant le dernier garant face à l’anarchie capitaliste et aux intérêts privés débridés. Et de fait, l’intervention concertée des banques centrales, le sauvetage des banques et le rachat d’actifs « pourris » ont été décisifs pour sortir de la crise. Dans la zone euro, cette intervention s’est menée par le biais de l’imposition par les Etats, en accord avec les institutions supranationales du FMI et de la BCE, de politiques d’austérité, qui dans les faits ont aussi été menées depuis les Etats les plus riches vers les Etats les plus pauvres, comme c’est flagrant dans le cas de la Grèce. Ce qui nous amène à une situation en apparence paradoxale dans laquelle ce sont des Etats qui travaillent à défaire la souveraineté nationale pour le plus grand bien du capitalisme.
Les frontières, autrefois synonymes d’enfermement et d’oppression, sont aujourd’hui conçues par certains comme des barrières de protection contre un ordre capitaliste qui ne cesse de les dissoudre pour fluidifier la circulation des marchandises, en même temps qu’il les renforce pour lutter contre la tragique circulation des hommes que la première engendre.
En 2009 avec les émeutes grecques et en 2011 avec les soulèvements arabes, une fenêtre insurrectionnelle a semblé s’ouvrir. Cependant, très rapidement, l’enjeu et le terrain de ces mouvements est devenu la société civile, et l’Etat, sa réforme et sa démocratisation, leur horizon exclusif. Si en Egypte comme en Tunisie les grèves ouvrières ont été massives, et ont pu en arriver à une situation de quasi-rupture avec l’Etat, pour diverses raisons parmi lesquelles la perspective de la répression ne peut pas être négligée (les chars de l’armée « protégeant » les manifestants des attaques des sbires de Moubarak ou se postant autour du canal de Suez posaient très concrètement la question de l’abolition l’Etat) on en est arrivés à une situation où la question de l’Etat, de sa légitimité, de sa capacité à refléter les attentes de la société civile, à se faire le garant d’une plus juste répartition des revenus et de la liberté de chacun de participer à la vie économique et sociale (la question de la corruption et de la monopolisation du pouvoir par une clique étant inévitable dans les pays arabes), sont devenus l’horizon de toutes les luttes de la période.
Le mouvement des places, de Tahrir à Taksim et jusqu’aux différentes versions d’Occupy aux Etats-Unis et en Europe ont fait de la société civile le cœur et l’enjeu des revendications, dans un mouvement mondial où, si le prolétariat était toujours présent à un degré où à un autre, la classe moyenne devenait de plus en plus centrale, à la fois comme réalité sociale et comme question politique. Ce mouvement, dès lors qu’il cesse d’être purement critique (comme le fut en Espagne le mouvement du 15M) et qu’il tend à revendiquer le pouvoir d’Etat au nom de la société civile, peut être adéquatement décrit sous le terme de « populisme ». Le populisme – lorsqu’il est de gauche ou « social » – est aussi le produit conjoint de l’échec de ces mouvements et de l’aggravation des mesures d’austérité ainsi que de la répression par l’Etat des mouvements purement contestataires.
Il faut situer cette montée du populisme dans ce moment qui suit « l’hiver arabe » et l’élection de Syriza en Grèce, et qui se caractérise – entre autres –par un retour mondial de la croissance (1). Ce moment de la « sortie de crise », c’est essentiellement celui des politiques d’austérité, l’aggravation des conditions d’exploitation des prolétaires et la fin de l’Etat-providence inconditionnel qui prévalait durant les Trente glorieuses. Pour autant, la flexibilisation du marché du travail ne peut fonctionner que si l’Etat endosse une part de la reproduction de la force de travail. Cette part devient alors l’objet de luttes sociales et politiques de la part des segments de classes qui en bénéficient et sont en mesure de la négocier. Ces luttes ont pour enjeu la définition de l’Etat et l’étendue de ses prérogatives, dans le cadre d’un libéralisme qu’aucun acteur ne remet véritablement en cause (le projet socialiste d’une économie dirigée par l’Etat étant définitivement enterré).
Par « populisme », il ne faut entendre ni une politique démagogique visant à instrumentaliser les classes les plus pauvres et les moins instruites, ni le simple nationalisme (encore que des éléments de ces deux acceptions puissent s’y retrouver), mais plutôt un mouvement interclassiste dans lequel l’union nationale ne se fait pas par identification des sujets à l’Etat « vers le haut » (comme dans le cas de la défense « populaire » d’une politique coloniale, par exemple), mais plutôt par reconnaissance horizontale de l’égalité des sujets au sein d’un ensemble national, et la redéfinition idéologique des rapports capitalistes sur la base de cette égalité posée comme substantielle. Concrètement, cela signifie la prééminence de l’Etat, considéré comme « chose du peuple », émanation de la communauté, et tenu dès lors responsable de l’existence concrète de cette égalité supposée. C’est ce dont parle Mélenchon en France en proposant un « processus constituant ». Pour la Catalogne et le mouvement séparatiste, formuler la prééminence du peuple sur l’Etat est ce qui lui permet d’affirmer que c’est le peuple lui-même qui définit « son » ensemble national, et non l’inverse.
Le populisme pose la question de la société civile, mais d’une façon toute particulière, en la présentant à la fois comme une communauté substantielle – le « peuple » – que ce soit sur un mode politique (l’appartenance à la République) ou ethnique (la langue, les coutumes, les origines) et comme une communauté matérielle, régie par l’Etat et existant dans les catégories du capitalisme. La communauté substantielle est dans le populisme ce qui confère sa légitimité à l’Etat, et elle est aussi le biais privilégié par lequel les rapports sociaux capitalistes sont fétichisés, ou plutôt le langage dans lequel s’exprime cette fétichisation.
Mais cette communauté substantielle n’est composée de rien d’autre que des rapports sociaux capitalistes, repeints aux couleurs supposées fraternelles du drapeau national. Entre l’employeur catalan et son ouvrier catalan, la langue est la même, mais le rapport d’exploitation qui continue à exister n’a ni langue ni drapeau, et la plus-value extraite s’en va rejoindre les autres capitaux sur le marché mondial, avant de revenir sur le coin de la gueule des prolétaires sous la forme d’accords de compétitivité passés, il est vrai, entre catalans.
La catégorie sociale à laquelle le populisme va s’opposer, ce n’est pas la bourgeoisie en tant que telle (exploiteuse, détentrice des moyens de production, etc.), dans la mesure où le patron comme l’ouvrier peuvent appartenir à la communauté substantielle du « peuple », même s’ils n’y ont pas la même position. Ici, le populisme se montre bien comme l’héritier du slogan des 99% contre les 1%. L’ennemi, ici aussi, ce seront les élites mondialisées, qui n’appartiennent à aucune communauté, classe circulante, mobile géographiquement et sans attaches communautaires, classe du global contre le local, de l’abstrait des flux financiers contre le concret de la production et des services.
C’est à cette « classe » des élites mondialisées que l’extrême-gauche séparatiste catalane propose de couper les ailes et de river au sol de la mère-patrie en bloquant ses avoirs au cas où elle songerait à quitter le territoire national après l’indépendance. Et de fait, ce sont bien les banques et les entreprises de l’Ibex 35 (le CAC 40 espagnol) qui ont les premières fait quitter le sol catalan à leurs sièges sociaux, dans un geste symbolique mais explicite de ralliement à Madrid. L’extrême-gauche populiste montre là ce en quoi le séparatisme exprime aussi un conflit entre secteurs de la bourgeoisie, entre la « petite » bourgeoisie du commerce et des services et la « grande » bourgeoisie des flux financiers mondialisés, posant ainsi dans ce conflit de classe le vieux thème citoyenniste de l’économie « réelle » opposée à l’économie « abstraite ». C’est bien cette bourgeoisie, à laquelle s’agrège indissolublement la classe moyenne, qui constitue ce vaste chœur de fonctionnaires, chefs d’entreprise, commerçants, avocats, médecins, auquel s’adjoignent des voix ouvrières et qui dit : « L’économie, c’est NOTRE travail, c’est NOUS qui produisons les richesses ». Et cela exprime dans le langage de l’idéologie cette vérité théorique : le capital, c’est la société elle-même.
Car évidemment, les élites mondialisées, ce sont également celles avec qui on commerce et pour lesquelles on travaille, et l’Union européenne est aussi leur lieu, le lieu des grands groupes financiers aussi bien qu’industriels qui ont massivement investi en Espagne, une fois que l’Etat (y compris par l’intermédiaire du gouvernement catalan) leur a préparé le terrain en leur offrant à domicile et sans droits de douanes une main-d’œuvre qualifiée à coût réduit ainsi qu’un vaste marché intérieur à conquérir. Dès lors, l’insertion dans le marché mondial que les séparatistes donnent comme un gage de crédibilité économique est précisément ce qui freine le processus d’indépendance. Car il n’est pas possible de séparer l’Etat de l’économie en réduisant l’Etat à une communauté de travailleurs actifs et d’entrepreneurs responsables s’en allant main dans la main créer de la richesse sur le marché mondial. La dette qu’il faudrait bien que Barcelone hérite de Madrid si elle quittait l’Espagne et recommençait un processus d’adhésion à l’UE, placerait immédiatement la Catalogne dans la situation de la Grèce. Car c’est également par le biais de la dette et des mesures d’austérité imposées par l’Etat que l’Espagne, et donc la Catalogne, s’insèrent dans le marché mondial : là aussi, les distinctions idéologiques opérées par le populisme s’avèrent impuissantes à saisir la réalité du moment qui les constitue.
L’interclassisme qui se manifeste dans la situation catalane s’opère de fait, comme à chaque fois, entre des segments de classes très déterminés, qui reflètent les conditions économiques de la région. En effet, si la Catalogne, précocement industrialisée, a conservé et développé une importante structure industrielle, notamment dans l’automobile ou dans le secteur en pleine expansion de la chimie, et s’est défaite du secteur agricole si important dans les régions les plus pauvres d’Espagne, ce sont les services qui forment la plus grosse part de son PIB (autour de 74%). Lors de la grève générale (autrement appelée « arrêt civique ») organisée le 3 octobre par les indépendantistes, ce sont majoritairement les services publics (transports, musées, etc.) et le secteur de la santé, concernés au premier chef par l’indépendance et touchés par les coupes budgétaires, et les secteurs du commerce (le port de marchandises) qui se sont mis en grève. Le Barça a fermé le Camp Nou, mais les Seat sont sorties des ateliers comme d’habitude. Il est vrai qu’en cas d’indépendance, les Catalans continueront à aller au stade et le Barça pourra poursuivre ses transferts à 40 millions d’euros, tandis qu’il n’est pas du tout certain que le constructeur allemand conserve ses usines sur place : à Martorell, près de Barcelone, où on a beaucoup transpiré pour la « reprise », ce sont 10 000 personnes qui se retrouveraient alors au chômage.
Mais si la question séparatiste en Catalogne peut être présentée comme une lutte entre secteurs de la bourgeoisie au sein de laquelle s’engagent des segments de classes dont les intérêts sont liés aux secteurs de la bourgeoisie catalane favorables à l’indépendance, il ne faut pas perdre de vue que ces intérêts sont aussi bien idéologiques que réels, sans qu’il soit vraiment possible de démêler l’un de l’autre. La thèse des masses manipulées par les bourgeois nationalistes reflète un profond mépris pour les dites « masses » : les « gens » – puisque dans le cas du populisme cette catégorie abstraite devient pertinente – ne sont pas des imbéciles qui se jettent aveuglément sur la première identité venue. Et de fait, la revendication d’indépendance est aussi une réaction aux mesures d’austérité prises par le gouvernement catalan lui-même, une façon de le prendre à son propre jeu, voire de s’opposer à lui.
Le moment populiste en Catalogne est celui de l’après-crise de 2008, qui a laissé l’Espagne sur les genoux, a vu les taux de chômage exploser et l’imposition de politiques d’austérité draconiennes. Avec la reprise du milieu des années 2010, et l’aide conjoncturelle de la baisse des cours du pétrole qui associée au moindre coût de la main-d’œuvre locale a donné un coup de pouce appréciable en termes de compétitivité internationale, la région Catalogne est parvenue à tirer son épingle du jeu économique, y compris en appliquant ces mesures d’austérité tant décriées.
En Catalogne comme partout ailleurs, « renouer avec la croissance » a été synonyme de baisses de salaires, de précarisation de l’emploi, de coupes dans les prestations sociales. Et en Catalogne en particulier, c’est bien le gouvernement local, et les indépendantistes au pouvoir, qui ont appliqué ces politiques d’austérité. Au sein de la mouvance indépendantiste aux affaires, ce sont par des luttes de pouvoir que ce sont manifestées des oppositions de classes prises dans le mouvement conjoint de l’austérité et de la « reprise ». L’enjeu du Procès d’indépendance est alors de donner un sens économique et social à la reprise de l’accumulation dans une aire particulière, la Catalogne, ce qui se manifeste alors par un conflit de nature politique. Dans un contexte social tendu, l’aile d’extrême-gauche CPU, avec un nombre de voix réduit au Parlement, joue un rôle d’arbitre : obtenir ses voix devient indispensable. En 2016, le président de la Generalitat, Artur Mas, qui a appliqué les mesures d’austérité, a fait les frais de cette situation et a dû céder la place à Carles Puidgemont, non moins de droite mais dont les convictions indépendantistes sont claires. Dès lors, politiquement, la tension consiste à faire de la question de l’indépendance une question « sociale », et c’est là que l’implication de masses de gens descendant dans la rue ne peut se réduire à de l’hystérie nationaliste ou à la manipulation par la bourgeoisie.
Dans ce cadre politique, l’organisation du référendum du 1er octobre est aussi pour la coalition au pouvoir, et notamment pour son aile droite, une façon de chevaucher le tigre du mécontentement des masses avant qu’elles ne se retournent contre lui. Désigner Madrid comme la source de tous les maux exempte le gouvernement de la Generalitat des reproches qui lui sont faits, et lui permet de rétablir l’unité de façade sans laquelle aucun Etat ne peut gouverner. Le populisme présente ainsi le double aspect d’un mouvement « populaire » et d’un mouvement de l’Etat, c’est-à-dire de la classe dominante, ce qui peut créer une situation mouvante, aux contours en permanente redéfinition.
Pour autant, ce caractère mouvant, lié à la nature interclassiste du populisme indique seulement que les classes, même liées par une identité supposée, sont en lutte permanente, c’est ce qui les définit comme classes. Le populisme comme idéologie masque sans doute les rapports de classe réels (il occulte l’exploitation), mais s’il les masque ils n’en continuent pas moins à exister en son sein même et à garder leur contenu conflictuel. Ce contenu est même ce qui rend le populisme nécessaire, çar aucune idéologie ne se forme autour de rapports transparents et horizontaux ; on ne dit rien d’autre lorsqu’on dit que le populisme exprime des conflits réels sous une forme idéologique. Mais tant que la situation demeure dans ce cadre, où l’enjeu de tous les segments de classes mobilisés est de poser chacun à leur manière le peuple, idéologiquement et pratiquement, comme communauté substantielle fondant l’Etat et reposant sur les rapports sociaux capitalistes (et donc sur leur occultation), et malgré les aspects spectaculaires que peut prendre ce mouvement, qui peut parfois se mettre lui-même en scène comme mouvement de rupture, il en reste aux limites qu’il s’est lui-même fixées et qu’il ne va pas dépasser comme malgré lui, sans s’en apercevoir. On ne fait pas la révolution comme on trébuche.
Si les segments du prolétariat qui se trouvent engagés dans l’articulation interclassiste des luttes actuelles n’arrivent pas à distinguer les intérêts réels « du » prolétariat de ceux de la bourgeoisie ou de la classe moyenne, c’est que ces « intérêts réels » ne sont réellement pas distincts. Il serait absurde de se contenter de déclarer que « le » prolétariat est internationaliste ou que le peuple tel qu’en lui-même ne peut être libre que sans l’Etat, comme si l’activité réelle de la classe se situait sur un plan où son existence sociale dans le capitalisme était purement accidentelle ou contingente face à la réalité transcendante de « la » classe.
Avec le populisme, on voit en quoi l’unification a priori, l’unité de classe réclamée et défendue par ceux pour lesquels la « convergence des luttes » conditionne leur réussite, est en réalité une pure et simple reconfirmation de l’ordre établi. Ce qui converge dans les luttes interclassistes, ce sont toujours des segments du prolétariat dont les intérêts recoupent ceux des classes moyennes, c’est cette jonction qui constitue la « société civile » comme objet de revendication, et dès lors que la société civile est le problème, ce sont les rapports sociaux capitalistes qui deviennent incontestables, parce qu’ils sont présupposés. Il n’y a plus dès lors qu’un problème de « répartition des richesses », sans qu’on sache de quelles « richesses » il s’agit et d’où elles peuvent bien provenir.
L’unification de la classe en classe révolutionnaire consisterait au contraire dans la multiplication des conflits portant sur ce qui la fait exister comme segmentée, dans les conditions posées par cette existence, c’est-à-dire non seulement l’exploitation qui est directement segmentation (division du travail), mais également les divisions de genre et raciales, mais aussi plus généralement tout ce qu’on peut appeler « inégalités » sociales. Concrètement, c’est une autre façon de dire que la classe ne s’unifie qu’en s’abolissant comme classe, en s’en prenant directement (même si ce directement peut impliquer des formulation idéologiques) à ce qui la fait exister comme classe exploitable et exploitée.
Cela dit, il nous faut bien constater que cette remise en cause de la classe par elle-même n’est guère à l’ordre du jour, si ce n’est négativement. Le moment populiste risque fort d’être un sale moment à passer. Car si le populisme nous est déjà peu sympathique dans ses conceptions, la réaction de l’Etat « classique » face à ce qui reste pour lui une contestation d’un ordre capitaliste déjà délicat à préserver risque fort de consister en de nouvelles mesures répressives et sécuritaires. Et partout, des mouvements nationalistes à composante populiste mais beaucoup moins « sociale » que celui des indépendantistes catalans voient le jour – ou même sont directement aux affaires, comme en Hongrie, en Pologne ou ailleurs.
Par ailleurs, les divers mouvements séparatistes qui participent à leur manière au mouvement de redéfinition de l’Etat indiquent également qu’à l’échelle mondiale la division de l’espace social et géographique déjà en cours avant la crise de 2008 ne fait que s’accentuer. Si elle n’est encore à poser qu’à titre d’hypothèse, la constitution conjointe de zones-poubelles peuplées de surnuméraires dépourvus d’instruments de lutte et de zones plus riches arc-boutées sur leurs supposés privilèges, qu’ils soient garantis par une appartenance culturelle, ethnique ou nationale n’est pas non plus une perspective réjouissante.
https://dndf.org/?p=16444
Tous les Etats européens se sont constitués, chacun à leur manière, sur la négation ou l’absorption des identités particulières présentes sur « leur » territoire, ce dont il reste évidemment des traces encore aujourd’hui. Mais si la question culturelle joue un rôle en Catalogne, ce n’est que comme cadre d’ensemble à une entité « Catalogne » qui reste avant tout comprise de façon économique. Ce qui est mis en avant dans les revendications, c’est moins la question de l’identité ou celle de la langue (en Catalogne, on soutient sa thèse en catalan) que celle de la fiscalité excessive qui briderait le développement de la région et contraindrait le gouvernement de la Generalitat à appliquer des mesures d’austérité imposées par Madrid. La question catalane pose alors la question des rapports entre l’Etat et le capital. Dans ce conflit, la formulation idéologique des rapports entre l’Etat, le « peuple » et l’économie devient un enjeu spécifique au sein de rapports de classes bien réels.
Après la crise de 2008, l’Etat est apparu comme étant le dernier garant face à l’anarchie capitaliste et aux intérêts privés débridés. Et de fait, l’intervention concertée des banques centrales, le sauvetage des banques et le rachat d’actifs « pourris » ont été décisifs pour sortir de la crise. Dans la zone euro, cette intervention s’est menée par le biais de l’imposition par les Etats, en accord avec les institutions supranationales du FMI et de la BCE, de politiques d’austérité, qui dans les faits ont aussi été menées depuis les Etats les plus riches vers les Etats les plus pauvres, comme c’est flagrant dans le cas de la Grèce. Ce qui nous amène à une situation en apparence paradoxale dans laquelle ce sont des Etats qui travaillent à défaire la souveraineté nationale pour le plus grand bien du capitalisme.
Les frontières, autrefois synonymes d’enfermement et d’oppression, sont aujourd’hui conçues par certains comme des barrières de protection contre un ordre capitaliste qui ne cesse de les dissoudre pour fluidifier la circulation des marchandises, en même temps qu’il les renforce pour lutter contre la tragique circulation des hommes que la première engendre.
En 2009 avec les émeutes grecques et en 2011 avec les soulèvements arabes, une fenêtre insurrectionnelle a semblé s’ouvrir. Cependant, très rapidement, l’enjeu et le terrain de ces mouvements est devenu la société civile, et l’Etat, sa réforme et sa démocratisation, leur horizon exclusif. Si en Egypte comme en Tunisie les grèves ouvrières ont été massives, et ont pu en arriver à une situation de quasi-rupture avec l’Etat, pour diverses raisons parmi lesquelles la perspective de la répression ne peut pas être négligée (les chars de l’armée « protégeant » les manifestants des attaques des sbires de Moubarak ou se postant autour du canal de Suez posaient très concrètement la question de l’abolition l’Etat) on en est arrivés à une situation où la question de l’Etat, de sa légitimité, de sa capacité à refléter les attentes de la société civile, à se faire le garant d’une plus juste répartition des revenus et de la liberté de chacun de participer à la vie économique et sociale (la question de la corruption et de la monopolisation du pouvoir par une clique étant inévitable dans les pays arabes), sont devenus l’horizon de toutes les luttes de la période.
Le mouvement des places, de Tahrir à Taksim et jusqu’aux différentes versions d’Occupy aux Etats-Unis et en Europe ont fait de la société civile le cœur et l’enjeu des revendications, dans un mouvement mondial où, si le prolétariat était toujours présent à un degré où à un autre, la classe moyenne devenait de plus en plus centrale, à la fois comme réalité sociale et comme question politique. Ce mouvement, dès lors qu’il cesse d’être purement critique (comme le fut en Espagne le mouvement du 15M) et qu’il tend à revendiquer le pouvoir d’Etat au nom de la société civile, peut être adéquatement décrit sous le terme de « populisme ». Le populisme – lorsqu’il est de gauche ou « social » – est aussi le produit conjoint de l’échec de ces mouvements et de l’aggravation des mesures d’austérité ainsi que de la répression par l’Etat des mouvements purement contestataires.
Il faut situer cette montée du populisme dans ce moment qui suit « l’hiver arabe » et l’élection de Syriza en Grèce, et qui se caractérise – entre autres –par un retour mondial de la croissance (1). Ce moment de la « sortie de crise », c’est essentiellement celui des politiques d’austérité, l’aggravation des conditions d’exploitation des prolétaires et la fin de l’Etat-providence inconditionnel qui prévalait durant les Trente glorieuses. Pour autant, la flexibilisation du marché du travail ne peut fonctionner que si l’Etat endosse une part de la reproduction de la force de travail. Cette part devient alors l’objet de luttes sociales et politiques de la part des segments de classes qui en bénéficient et sont en mesure de la négocier. Ces luttes ont pour enjeu la définition de l’Etat et l’étendue de ses prérogatives, dans le cadre d’un libéralisme qu’aucun acteur ne remet véritablement en cause (le projet socialiste d’une économie dirigée par l’Etat étant définitivement enterré).
Par « populisme », il ne faut entendre ni une politique démagogique visant à instrumentaliser les classes les plus pauvres et les moins instruites, ni le simple nationalisme (encore que des éléments de ces deux acceptions puissent s’y retrouver), mais plutôt un mouvement interclassiste dans lequel l’union nationale ne se fait pas par identification des sujets à l’Etat « vers le haut » (comme dans le cas de la défense « populaire » d’une politique coloniale, par exemple), mais plutôt par reconnaissance horizontale de l’égalité des sujets au sein d’un ensemble national, et la redéfinition idéologique des rapports capitalistes sur la base de cette égalité posée comme substantielle. Concrètement, cela signifie la prééminence de l’Etat, considéré comme « chose du peuple », émanation de la communauté, et tenu dès lors responsable de l’existence concrète de cette égalité supposée. C’est ce dont parle Mélenchon en France en proposant un « processus constituant ». Pour la Catalogne et le mouvement séparatiste, formuler la prééminence du peuple sur l’Etat est ce qui lui permet d’affirmer que c’est le peuple lui-même qui définit « son » ensemble national, et non l’inverse.
Le populisme pose la question de la société civile, mais d’une façon toute particulière, en la présentant à la fois comme une communauté substantielle – le « peuple » – que ce soit sur un mode politique (l’appartenance à la République) ou ethnique (la langue, les coutumes, les origines) et comme une communauté matérielle, régie par l’Etat et existant dans les catégories du capitalisme. La communauté substantielle est dans le populisme ce qui confère sa légitimité à l’Etat, et elle est aussi le biais privilégié par lequel les rapports sociaux capitalistes sont fétichisés, ou plutôt le langage dans lequel s’exprime cette fétichisation.
Mais cette communauté substantielle n’est composée de rien d’autre que des rapports sociaux capitalistes, repeints aux couleurs supposées fraternelles du drapeau national. Entre l’employeur catalan et son ouvrier catalan, la langue est la même, mais le rapport d’exploitation qui continue à exister n’a ni langue ni drapeau, et la plus-value extraite s’en va rejoindre les autres capitaux sur le marché mondial, avant de revenir sur le coin de la gueule des prolétaires sous la forme d’accords de compétitivité passés, il est vrai, entre catalans.
La catégorie sociale à laquelle le populisme va s’opposer, ce n’est pas la bourgeoisie en tant que telle (exploiteuse, détentrice des moyens de production, etc.), dans la mesure où le patron comme l’ouvrier peuvent appartenir à la communauté substantielle du « peuple », même s’ils n’y ont pas la même position. Ici, le populisme se montre bien comme l’héritier du slogan des 99% contre les 1%. L’ennemi, ici aussi, ce seront les élites mondialisées, qui n’appartiennent à aucune communauté, classe circulante, mobile géographiquement et sans attaches communautaires, classe du global contre le local, de l’abstrait des flux financiers contre le concret de la production et des services.
C’est à cette « classe » des élites mondialisées que l’extrême-gauche séparatiste catalane propose de couper les ailes et de river au sol de la mère-patrie en bloquant ses avoirs au cas où elle songerait à quitter le territoire national après l’indépendance. Et de fait, ce sont bien les banques et les entreprises de l’Ibex 35 (le CAC 40 espagnol) qui ont les premières fait quitter le sol catalan à leurs sièges sociaux, dans un geste symbolique mais explicite de ralliement à Madrid. L’extrême-gauche populiste montre là ce en quoi le séparatisme exprime aussi un conflit entre secteurs de la bourgeoisie, entre la « petite » bourgeoisie du commerce et des services et la « grande » bourgeoisie des flux financiers mondialisés, posant ainsi dans ce conflit de classe le vieux thème citoyenniste de l’économie « réelle » opposée à l’économie « abstraite ». C’est bien cette bourgeoisie, à laquelle s’agrège indissolublement la classe moyenne, qui constitue ce vaste chœur de fonctionnaires, chefs d’entreprise, commerçants, avocats, médecins, auquel s’adjoignent des voix ouvrières et qui dit : « L’économie, c’est NOTRE travail, c’est NOUS qui produisons les richesses ». Et cela exprime dans le langage de l’idéologie cette vérité théorique : le capital, c’est la société elle-même.
Car évidemment, les élites mondialisées, ce sont également celles avec qui on commerce et pour lesquelles on travaille, et l’Union européenne est aussi leur lieu, le lieu des grands groupes financiers aussi bien qu’industriels qui ont massivement investi en Espagne, une fois que l’Etat (y compris par l’intermédiaire du gouvernement catalan) leur a préparé le terrain en leur offrant à domicile et sans droits de douanes une main-d’œuvre qualifiée à coût réduit ainsi qu’un vaste marché intérieur à conquérir. Dès lors, l’insertion dans le marché mondial que les séparatistes donnent comme un gage de crédibilité économique est précisément ce qui freine le processus d’indépendance. Car il n’est pas possible de séparer l’Etat de l’économie en réduisant l’Etat à une communauté de travailleurs actifs et d’entrepreneurs responsables s’en allant main dans la main créer de la richesse sur le marché mondial. La dette qu’il faudrait bien que Barcelone hérite de Madrid si elle quittait l’Espagne et recommençait un processus d’adhésion à l’UE, placerait immédiatement la Catalogne dans la situation de la Grèce. Car c’est également par le biais de la dette et des mesures d’austérité imposées par l’Etat que l’Espagne, et donc la Catalogne, s’insèrent dans le marché mondial : là aussi, les distinctions idéologiques opérées par le populisme s’avèrent impuissantes à saisir la réalité du moment qui les constitue.
L’interclassisme qui se manifeste dans la situation catalane s’opère de fait, comme à chaque fois, entre des segments de classes très déterminés, qui reflètent les conditions économiques de la région. En effet, si la Catalogne, précocement industrialisée, a conservé et développé une importante structure industrielle, notamment dans l’automobile ou dans le secteur en pleine expansion de la chimie, et s’est défaite du secteur agricole si important dans les régions les plus pauvres d’Espagne, ce sont les services qui forment la plus grosse part de son PIB (autour de 74%). Lors de la grève générale (autrement appelée « arrêt civique ») organisée le 3 octobre par les indépendantistes, ce sont majoritairement les services publics (transports, musées, etc.) et le secteur de la santé, concernés au premier chef par l’indépendance et touchés par les coupes budgétaires, et les secteurs du commerce (le port de marchandises) qui se sont mis en grève. Le Barça a fermé le Camp Nou, mais les Seat sont sorties des ateliers comme d’habitude. Il est vrai qu’en cas d’indépendance, les Catalans continueront à aller au stade et le Barça pourra poursuivre ses transferts à 40 millions d’euros, tandis qu’il n’est pas du tout certain que le constructeur allemand conserve ses usines sur place : à Martorell, près de Barcelone, où on a beaucoup transpiré pour la « reprise », ce sont 10 000 personnes qui se retrouveraient alors au chômage.
Mais si la question séparatiste en Catalogne peut être présentée comme une lutte entre secteurs de la bourgeoisie au sein de laquelle s’engagent des segments de classes dont les intérêts sont liés aux secteurs de la bourgeoisie catalane favorables à l’indépendance, il ne faut pas perdre de vue que ces intérêts sont aussi bien idéologiques que réels, sans qu’il soit vraiment possible de démêler l’un de l’autre. La thèse des masses manipulées par les bourgeois nationalistes reflète un profond mépris pour les dites « masses » : les « gens » – puisque dans le cas du populisme cette catégorie abstraite devient pertinente – ne sont pas des imbéciles qui se jettent aveuglément sur la première identité venue. Et de fait, la revendication d’indépendance est aussi une réaction aux mesures d’austérité prises par le gouvernement catalan lui-même, une façon de le prendre à son propre jeu, voire de s’opposer à lui.
Le moment populiste en Catalogne est celui de l’après-crise de 2008, qui a laissé l’Espagne sur les genoux, a vu les taux de chômage exploser et l’imposition de politiques d’austérité draconiennes. Avec la reprise du milieu des années 2010, et l’aide conjoncturelle de la baisse des cours du pétrole qui associée au moindre coût de la main-d’œuvre locale a donné un coup de pouce appréciable en termes de compétitivité internationale, la région Catalogne est parvenue à tirer son épingle du jeu économique, y compris en appliquant ces mesures d’austérité tant décriées.
En Catalogne comme partout ailleurs, « renouer avec la croissance » a été synonyme de baisses de salaires, de précarisation de l’emploi, de coupes dans les prestations sociales. Et en Catalogne en particulier, c’est bien le gouvernement local, et les indépendantistes au pouvoir, qui ont appliqué ces politiques d’austérité. Au sein de la mouvance indépendantiste aux affaires, ce sont par des luttes de pouvoir que ce sont manifestées des oppositions de classes prises dans le mouvement conjoint de l’austérité et de la « reprise ». L’enjeu du Procès d’indépendance est alors de donner un sens économique et social à la reprise de l’accumulation dans une aire particulière, la Catalogne, ce qui se manifeste alors par un conflit de nature politique. Dans un contexte social tendu, l’aile d’extrême-gauche CPU, avec un nombre de voix réduit au Parlement, joue un rôle d’arbitre : obtenir ses voix devient indispensable. En 2016, le président de la Generalitat, Artur Mas, qui a appliqué les mesures d’austérité, a fait les frais de cette situation et a dû céder la place à Carles Puidgemont, non moins de droite mais dont les convictions indépendantistes sont claires. Dès lors, politiquement, la tension consiste à faire de la question de l’indépendance une question « sociale », et c’est là que l’implication de masses de gens descendant dans la rue ne peut se réduire à de l’hystérie nationaliste ou à la manipulation par la bourgeoisie.
Dans ce cadre politique, l’organisation du référendum du 1er octobre est aussi pour la coalition au pouvoir, et notamment pour son aile droite, une façon de chevaucher le tigre du mécontentement des masses avant qu’elles ne se retournent contre lui. Désigner Madrid comme la source de tous les maux exempte le gouvernement de la Generalitat des reproches qui lui sont faits, et lui permet de rétablir l’unité de façade sans laquelle aucun Etat ne peut gouverner. Le populisme présente ainsi le double aspect d’un mouvement « populaire » et d’un mouvement de l’Etat, c’est-à-dire de la classe dominante, ce qui peut créer une situation mouvante, aux contours en permanente redéfinition.
Pour autant, ce caractère mouvant, lié à la nature interclassiste du populisme indique seulement que les classes, même liées par une identité supposée, sont en lutte permanente, c’est ce qui les définit comme classes. Le populisme comme idéologie masque sans doute les rapports de classe réels (il occulte l’exploitation), mais s’il les masque ils n’en continuent pas moins à exister en son sein même et à garder leur contenu conflictuel. Ce contenu est même ce qui rend le populisme nécessaire, çar aucune idéologie ne se forme autour de rapports transparents et horizontaux ; on ne dit rien d’autre lorsqu’on dit que le populisme exprime des conflits réels sous une forme idéologique. Mais tant que la situation demeure dans ce cadre, où l’enjeu de tous les segments de classes mobilisés est de poser chacun à leur manière le peuple, idéologiquement et pratiquement, comme communauté substantielle fondant l’Etat et reposant sur les rapports sociaux capitalistes (et donc sur leur occultation), et malgré les aspects spectaculaires que peut prendre ce mouvement, qui peut parfois se mettre lui-même en scène comme mouvement de rupture, il en reste aux limites qu’il s’est lui-même fixées et qu’il ne va pas dépasser comme malgré lui, sans s’en apercevoir. On ne fait pas la révolution comme on trébuche.
Si les segments du prolétariat qui se trouvent engagés dans l’articulation interclassiste des luttes actuelles n’arrivent pas à distinguer les intérêts réels « du » prolétariat de ceux de la bourgeoisie ou de la classe moyenne, c’est que ces « intérêts réels » ne sont réellement pas distincts. Il serait absurde de se contenter de déclarer que « le » prolétariat est internationaliste ou que le peuple tel qu’en lui-même ne peut être libre que sans l’Etat, comme si l’activité réelle de la classe se situait sur un plan où son existence sociale dans le capitalisme était purement accidentelle ou contingente face à la réalité transcendante de « la » classe.
Avec le populisme, on voit en quoi l’unification a priori, l’unité de classe réclamée et défendue par ceux pour lesquels la « convergence des luttes » conditionne leur réussite, est en réalité une pure et simple reconfirmation de l’ordre établi. Ce qui converge dans les luttes interclassistes, ce sont toujours des segments du prolétariat dont les intérêts recoupent ceux des classes moyennes, c’est cette jonction qui constitue la « société civile » comme objet de revendication, et dès lors que la société civile est le problème, ce sont les rapports sociaux capitalistes qui deviennent incontestables, parce qu’ils sont présupposés. Il n’y a plus dès lors qu’un problème de « répartition des richesses », sans qu’on sache de quelles « richesses » il s’agit et d’où elles peuvent bien provenir.
L’unification de la classe en classe révolutionnaire consisterait au contraire dans la multiplication des conflits portant sur ce qui la fait exister comme segmentée, dans les conditions posées par cette existence, c’est-à-dire non seulement l’exploitation qui est directement segmentation (division du travail), mais également les divisions de genre et raciales, mais aussi plus généralement tout ce qu’on peut appeler « inégalités » sociales. Concrètement, c’est une autre façon de dire que la classe ne s’unifie qu’en s’abolissant comme classe, en s’en prenant directement (même si ce directement peut impliquer des formulation idéologiques) à ce qui la fait exister comme classe exploitable et exploitée.
Cela dit, il nous faut bien constater que cette remise en cause de la classe par elle-même n’est guère à l’ordre du jour, si ce n’est négativement. Le moment populiste risque fort d’être un sale moment à passer. Car si le populisme nous est déjà peu sympathique dans ses conceptions, la réaction de l’Etat « classique » face à ce qui reste pour lui une contestation d’un ordre capitaliste déjà délicat à préserver risque fort de consister en de nouvelles mesures répressives et sécuritaires. Et partout, des mouvements nationalistes à composante populiste mais beaucoup moins « sociale » que celui des indépendantistes catalans voient le jour – ou même sont directement aux affaires, comme en Hongrie, en Pologne ou ailleurs.
Par ailleurs, les divers mouvements séparatistes qui participent à leur manière au mouvement de redéfinition de l’Etat indiquent également qu’à l’échelle mondiale la division de l’espace social et géographique déjà en cours avant la crise de 2008 ne fait que s’accentuer. Si elle n’est encore à poser qu’à titre d’hypothèse, la constitution conjointe de zones-poubelles peuplées de surnuméraires dépourvus d’instruments de lutte et de zones plus riches arc-boutées sur leurs supposés privilèges, qu’ils soient garantis par une appartenance culturelle, ethnique ou nationale n’est pas non plus une perspective réjouissante.
AC
1. Pour une description plus approfondie de cette période, on peut lire dans le n° 25 de la revue Théorie communiste la (longue) partie intitulée « Une séquence particulière ». On en trouve des extraits choisis ici :
Spanish translation here :https://dndf.org/?p=16444
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire